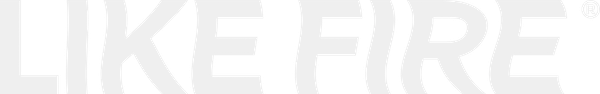LE JAZZ, UNE CONVERSATION MONDIALE
by @itsjayythehost
Le jazz a longtemps été raconté comme une histoire américaine et à juste titre. Ses grandes figures, de Louis Armstrong à Miles Davis en passant par Ella Fitzgerald, incarnaient la trajectoire d’un genre devenu symbole de modernité au XXᵉ siècle.
Mais, derrière ce récit centré sur l’Amérique, une autre histoire s’est écrite, plus souterraine, faite de circulations, de diasporas et de contextes locaux. Aujourd’hui, il n’existe plus un seul centre, mais une cartographie mondiale du jazz, où Londres, Chicago, Lagos ou Paris deviennent des pôles importants.
Héritages et tensions
Cette internationalisation n’est pas le produit d’une ouverture soudaine, mais le résultat de plusieurs étapes historiques. Dans l’après-guerre, des musiciens afro-américains installés en Europe ouvrent la voie à une circulation nouvelle.
Quincy Jones, jeune trompettiste et arrangeur, débarque à Paris à la fin des années 1950. Il y étudie auprès de Nadia Boulanger et Messiaen , fréquente des orchestres, apprend à écrire, diriger, arranger. Ce séjour parisien n’est pas une parenthèse pittoresque : il a façonné sa vision globale de la musique et montré comment une capitale européenne pouvait être un laboratoire d’apprentissage et de professionnalisation.
Dans le même temps, des artistes comme Bud Powell (pianiste) ou Dexter Gordon (saxophoniste) trouvaient à Paris un espace pour jouer et enregistrer, mais aussi la reconnaissance que leurs propres pays tardaient à leur accorder. Pourtant, ce récit d’un refuge européen ne doit pas masquer une réalité moins reluisante : le jazz a aussi été capté par les élites culturelles comme objet patrimonial, légitimé par les institutions plus qu’écouté dans les clubs. Cette tension entre vitalité populaire et récupération symbolique traverse encore aujourd’hui les scènes jazz.
Pour comprendre comment le jazz s’exprime au XXIᵉ siècle, il faut poser un regard sur quatre scènes représentatives : Londres, Chicago, Lagos et Paris. Ce choix ne vise pas à réduire la carte mondiale, mais à montrer comment, dans ces lieux, se condensent certaines des évolutions majeures du jazz contemporain.
Londres : la renaissance par les diasporas
Au cours des années 2010, Londres est devenue le foyer d’une scène qui a replacé le jazz au cœur des conversations contemporaines. Ici, le jazz n’a pas été muséifié. Il a trouvé dans les diasporas caribéennes et africaines une matière vive, croisant les héritages du reggae, du calypso, de l’afrobeat avec l’énergie de la grime, du hip-hop et des musiques électroniques.
Des musiciens comme Shabaka Hutchings, avec Sons of Kemet ou The Comet Is Coming, ont formulé un jazz abrasif, politique, taillé pour la rue autant que pour les festivals.
Ezra Collective, porté par le batteur Femi Koleoso, propose une approche festive et fédératrice, où l’on entend aussi bien l’héritage de Fela Kuti que celui d’Herbie Hancock.
La saxophoniste Nubya Garcia développe un son ample et mélodique, nourri de ses origines guyanaises et trinidadiennes, tandis que la trompettiste Emma-Jean Thackray assume l’influence du rap, des musiques électroniques et de la house dans ses improvisations.
La batterie de Yussef Dayes, nerveuse et cinématique, illustre parfaitement cette hybridité contemporaine : un langage rythmique qui oscille entre jazz, hip-hop et afrobeat. Autour de lui gravitent des musiciens comme le saxophoniste Venna, figure essentielle de cette constellation.
En 2025, il sort son premier album MALIK, nouvelle étape dans l’affirmation de cette scène qui relie héritages jazz et langages contemporains.
Derrière cette vitalité, on trouve aussi des infrastructures clés : le label Brownswood de Gilles Peterson, la plateforme musicale Jazz re:freshed, ou encore des tiers-lieux créatif comme Total Refreshment Centre. Ces espaces ont permis à cette génération d’avoir une scène, un public et un écosystème durable.
Résultat : le jazz londonien ne se vit pas seulement comme une musique savante, mais comme une culture vivante qui dialogue avec le quotidien des diasporas.
Chicago : la tradition de l’avant-garde
À l’autre bout de l’Atlantique, Chicago incarne une autre dynamique : celle d’une avant-garde enracinée dans l’expérience afro-américaine et tournée vers le monde.
L’Association for the Advancement of Creative Musicians (AACM), fondée dans les années 1960, a installé une tradition d’expérimentation radicale.
L’Art Ensemble of Chicago, en exil à Paris à la fin des années 60, a donné au jazz une dimension théâtrale et rituelle. Sur scène, les musiciens utilisaient non seulement leurs instruments mais aussi des objets du quotidien —jouets d’enfants, casseroles, — élargissant le spectre sonore et brouillant la frontière entre musique et vie.
Aujourd’hui, cette culture de l’expérimentation se perpétue avec des artistes comme Makaya McCraven, batteur et producteur né à Paris et installé à Chicago. Son album Universal Beings (2018) relie Chicago, New York, Los Angeles et Londres en un seul projet, mettant en réseau des musiciens de scènes différentes mais connectées par une même approche de l’improvisation et de la production.
À ses côtés, la violoncelliste Tomeka Reid ou le cornettiste Rob Mazurek prolongent l’esprit de l’AACM : inventer des formats nouveaux, hybrider improvisation et composition, tout en gardant un ancrage politique fort.
Chicago n’exporte pas seulement des sons : elle exporte une méthode — celle d’un jazz conçu comme atelier collectif et laboratoire permanent.
Lagos : l’afrobeat comme langage jazz
Pour comprendre la scène de Lagos, il faut poser le contexte : un Nigéria sorti de la colonisation britannique, traversé par l’euphorie de l’indépendance mais désormais confronté aux coups d’État et la répression. C’est dans ce climat que Fela Kuti invente l’afrobeat.
Après des études musicales en Angleterre, il séjourne aux États-Unis à la fin des années 1960, où il découvre les mouvements des droits civiques et rencontre les Black Panthers via Sandra Isidore. De retour à Lagos, il conjugue conscience politique, rythmes yoruba et improvisation jazz pour créer une musique hypnotique, écrite pour la danse mais aussi pour la contestation.
Avec Tony Allen, batteur visionnaire, il compose des morceaux fleuves où le groove devient une arme.
Aujourd’hui à Lagos, cette énergie est toujours palpable. Les fils de Fela, Femi et Seun Kuti, perpétuent l’afrobeat dans ses dimensions explosive et revendicative.
Le trompettiste Etuk Ubong a créé The Truth Village, un lieu qui est à la fois un club et un espace communautaire, devenu central pour la scène locale. On y croise une génération qui assume l’héritage tout en le réinventant.
Le batteur Ayo Salawu, membre du groupe londonien Kokoroko et issu d’une famille nigériane, incarne cette circulation constante entre diasporas et scènes locales.
Ici, le jazz n’est pas un genre « importé », mais une énergie politique et sociale, qui résonne avec les réalités urbaines nigérianes et continue de dialoguer avec le monde.
Paris : un carrefour en tension mais productif
Depuis un siècle, Paris occupe une place singulière dans la cartographie du jazz. Ville d’accueil pour de nombreux artistes exilés — i.e des écrivains comme James Baldwin ou Richard Wright —, elle fut aussi un terrain d’expérimentation pour des figures du jazz venues chercher reconnaissance et conditions de travail, comme évoqué plus haut.
Mais la capitale a aussi figé le jazz dans une image patrimoniale, portée par des festivals institutionnels et des récits officiels, parfois déconnectés de la vitalité réelle des clubs.
Pourtant, Paris est loin d’être qu’une vitrine. Dès les années 1970, Manu Dibango y installe un afro-jazz qui marquera durablement la pop mondiale.
Plus tard, Tony Allen, installé en France, collabore avec Damon Albarn (Blur, Gorillaz….) ou Moritz von Oswald (producteur de musique électronique berlinois), ouvrant un espace où l’afrobeat dialogue avec les musiques électroniques et le jazz contemporain.
Aujourd’hui, de nouvelles générations nourrissent cette dynamique. La batteuse Anne Paceo, trois fois primée aux Victoires du Jazz, a sorti Fables of Shwedagon (2018), inspiré de ses séjours en Birmanie et enregistré avec l’ensemble traditionnel Hsaing Waing : une manière d’intégrer un autre univers rythmique et narratif au langage du jazz.
La harpiste, directrice de chœur et interprète Sophye Soliveau, formée au classique et nourrie par les histoires afro-diasporiques, développe une approche singulière où la harpe dialogue avec la voix, le gospel, la soul, le R&B. Son premier album Initiation (2024), est une perle rare et le portrait de ce que peut être le jazz aujourd’hui.
Paris reste également portée par une activité de clubs et de collectifs : des lieux comme La Gare, le New Morning 38Riv… en sont quelques repères de la capitale.
Paris reste ainsi un carrefour : traversé de contradictions, mais moteur de circulations nouvelles.
Le jazz comme langue vivante
Si le jazz est une langue mondiale, c’est grâce à un ensemble de circulations : celles des diasporas noires qui en ont porté les héritages, mais aussi celles des musiciens afro-américains en tournée, des acteurs culturels (festivals, labels, clubs…), et des artistes et scènes du monde entier qui l’ont interprété et réinventé.
Cette langue est faite de dialectes. Non seulement parce qu’elle s’exprime depuis des géographies différentes, mais aussi parce qu’elle dialogue sans cesse avec d’autres genres musicaux. Le concept de TrapHouseJazz, développé par Masego, en est une illustration éclatante : une musique qui emprunte au jazz son langage harmonique et sa liberté d’improvisation, tout en fusionnant avec les textures de la trap et de la soul.
Le jazz n’a rien d’un monument figé. C’est une conversation en mouvement, qui continue de traverser les frontières et les styles, en gardant intacte sa capacité à dire le monde autrement.