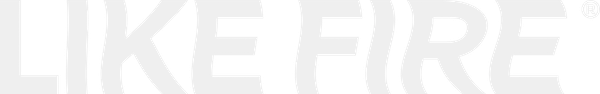HOUSE ET R&B, GRAND PONT SUR LE DANCE FLOOR
Kaytranada. (Photo Credit: Hannah Sider)
By @itsjaythehost
La house et le R&B moderne sont comme deux cousines. Élevées dans le même foyer musical (gospel, soul, funk, disco), elles ont fini par suivre des chemins différents.
Mais à chaque retrouvaille, la même complicité refait surface.
L’une s’est épanouie dans les clubs underground de Chicago et de New York, avant de résonner sur les dancefloors du monde entier. L’autre a trouvé son terrain d’expression dans les studios de super-producteurs et les canaux mainstream, tout en dialoguant avec la club culture.
Depuis, elles n’ont jamais cessé de se croiser et de se répondre.
Chicago, New York : les laboratoires fondateurs de la house
En 1977, Robert Williams, promoteur afro-américain, ouvre le Warehouse à Chicago.
Il met en place un système d’adhésion, refuse la vente d’alcool et fait de la musique le centre du lieu. Aux platines, il engage Frankie Knuckles, DJ du Bronx passé par la scène new-yorkaise aux côtés de Larry Levan.
The dance floor of The Warehouse.
Knuckles manipule les classiques disco et funk, les étire, les recolle, les réinvente avec les nouvelles boîtes à rythmes Roland (TR-808 et TR-909).
Ses sets hypnotiques donnent naissance à un nouveau son, bientôt baptisé “house” en hommage au Warehouse.
À New York, c’est le Paradise Garage qui devient légendaire dès 1978.
Le club accueille un public majoritairement noir, latino et queer – des communautés à la source de l’histoire des musiques électroniques modernes.
Son DJ résident, Larry Levan, devient une figure centrale de la culture club. Ses sets, où il mélange disco, funk et ballades R&B, se distinguent par leur intensité émotionnelle : silence prolongé, refrain relancé au bon moment, montée dramatique sur la piste.
The dance floor of the Paradise Garage
(source : Vice)
De ce lieu naîtra une esthétique particulière, qu’on appellera plus tard le garage (ou garage house) : des productions centrées sur des voix puissantes, des arrangements riches, une approche plus organique et soulful que la house de Chicago.
Dans ces clubs, la cabine DJ devient un véritable laboratoire où l’on expérimente de nouvelles formes en temps réel.
Deux voies divergentes
À partir du milieu des années 80, la house s’exporte grâce à des labels indépendants comme Trax Records. Des morceaux comme Your Love (Frankie Knuckles & Jamie Principle) ou Move Your Body (Marshall Jefferson) fixent les bases d’une musique répétitive et percussive, conçue pour danser sans fin.
La house s’installe à Londres, Manchester, Ibiza ou Paris, et se diversifie en sous-genres (acid house, deep house, ghetto house, footwork).
À Detroit, Juan Atkins, Derrick May et Kevin Saunderson inventent la techno : un courant parallèle, nourri des mêmes racines disco-funk, mais plus futuriste et mécanique
À la fin des années 1990, cette filiation se prolonge de l’autre côté de l’Atlantique avec le UK garage. Né dans les clubs londoniens et sur les radios pirates, il reprend l’héritage soulful du garage new-yorkais en l’accélérant : rythmiques plus rapides, basses syncopées, voix R&B mises en avant.
Des producteurs comme Artful Dodger ou MJ Cole façonnent ce son hybride, à la fois underground et populaire, qui propulse Craig David sur le devant de la scène.
Le UK garage installe au Royaume-Uni une tradition durable de dialogue entre club et R&B.
Pendant ce temps, le R&B moderne s’impose à un niveau mainstream global.
À Los Angeles et Minneapolis, Jimmy Jam & Terry Lewis créent le son de Janet Jackson avec Control (1986). À New York, Teddy Riley invente le New Jack Swing : un style hybride qui combine voix R&B, rythmiques hip-hop et programmations électroniques.
Le New Jack Swing marque un moment charnière : en mêlant chant, rap et outils électroniques, Riley insuffle au R&B une logique de danse héritée des clubs, même si son esthétique reste distincte de la house.
Des titres comme My Prerogative (Bobby Brown) ou Remember the Time (Michael Jackson) traduisent cette ouverture : des hits pensés pour la radio, mais nourris d’une énergie rythmique qui fait écho à la club culture.
Passerelles permanentes
Les ponts entre house et R&B sont multiples.
Dès 1993, Mariah Carey s’entoure du producteur David Morales, qui transforme Dreamlover en marathon house de dix minutes. Ses autres singles (Fantasy, Always Be My Baby) connaissent le même destin.
Le duo Masters at Work (Louie Vega et Kenny Gonzalez) brouille aussi les frontières : ils remixent aussi bien Madonna que les grandes voix R&B, tout en lançant le projet Nuyorican Soul, fusion jazz, funk, latin et house.
D’autres producteurs comme The Neptunes ou Darkchild importent dans le R&B mainstream une efficacité héritée des musiques de club.
À Londres, des DJs comme Norman Jay injectent régulièrement des voix soul dans leurs sets house.
Hybridations contemporaines
Aujourd’hui, cette logique reste vivante.
Kaytranada, DJ et producteur canadien, en est sans doute l’exemple le plus éclatant. Ses albums, ancrés dans une base dance/house/électronique et nourris de collaborations avec des artistes R&B, lui valent deux Grammy Awards pour BUBBA (2019) — dont celui de Best Dance/Electronic Album, une première pour un artiste noir.
Une distinction symbolique, qui remet en avant l’apport des musiciens noirs et queer dans des musiques électroniques qu’ils ont façonnées dès l’origine.
Quelques années plus tard, Beyoncé pousse cette reconnaissance encore plus loin avec RENAISSANCE (2022), un hommage explicite à la house, au disco et à la culture ballroom.
Elle s’entoure de figures issues de ces scènes (Honey Dijon, Green Velvet), interpole ou sample des classiques house (Show Me Love de Robin S pour Break My Soul, Get With U de Lidell Townsell et T.M.F pour Cozy), et enchaîne les morceaux comme dans un set de DJ.
L’album replace la house au cœur du mainstream.
Cette insertion dans la pop mondiale se retrouve aussi chez d’autres figures : Drake, avec Honestly, Nevermind (2022), s’essaie à une esthétique house, tandis que Jorja Smith, avec Little Things (2023), surprend par un virage plus uptempo et club – même si en tant qu’anglaise, cet héritage fait partie de son bagage culturel.
À côté de ces stars, Rochelle Jordan développe une proposition marquante : un R&B progressif nourri par la house, le UK garage et la club culture britannique.
Sa musique séduit par sa précision et son audace, et s’impose comme l’une des propositions les plus solides de cette scène hybride.
Ces voix confirment que le lien house–R&B/soul n’est pas seulement l’affaire d’albums événementiels, mais une esthétique vivante et multiple.
Retrouvailles en club
La trajectoire de la house et du R&B rappelle à quel point le club a toujours été un espace de création.
Aujourd’hui, cette esthétique déborde largement ces deux genres : on en retrouve l’empreinte dans le hip-hop de Tyler, The Creator (Don’t Tap The Glass), dans l’afropop de Tyla (WWP – We Want to Party), ou encore dans des projets français comme Triangle des Bermudes.
Tous reprennent à leur manière le souffle du club : ses rythmes, sa capacité à transformer les influences.
Cela dit, le club est moins central qu’à d’autres époques. On a vu apparaître de nouvelles formes de rassemblement, plus éclatées, plus digitales ou hybrides, qui déplacent l’attention ailleurs que sur la piste de danse.
N’en demeure pas moins que le club reste un centre d’exploration : un endroit où les artistes testent leurs morceaux, où les publics se retrouvent autour des sons, et où les prochaines directions de la musique peuvent se dessiner.